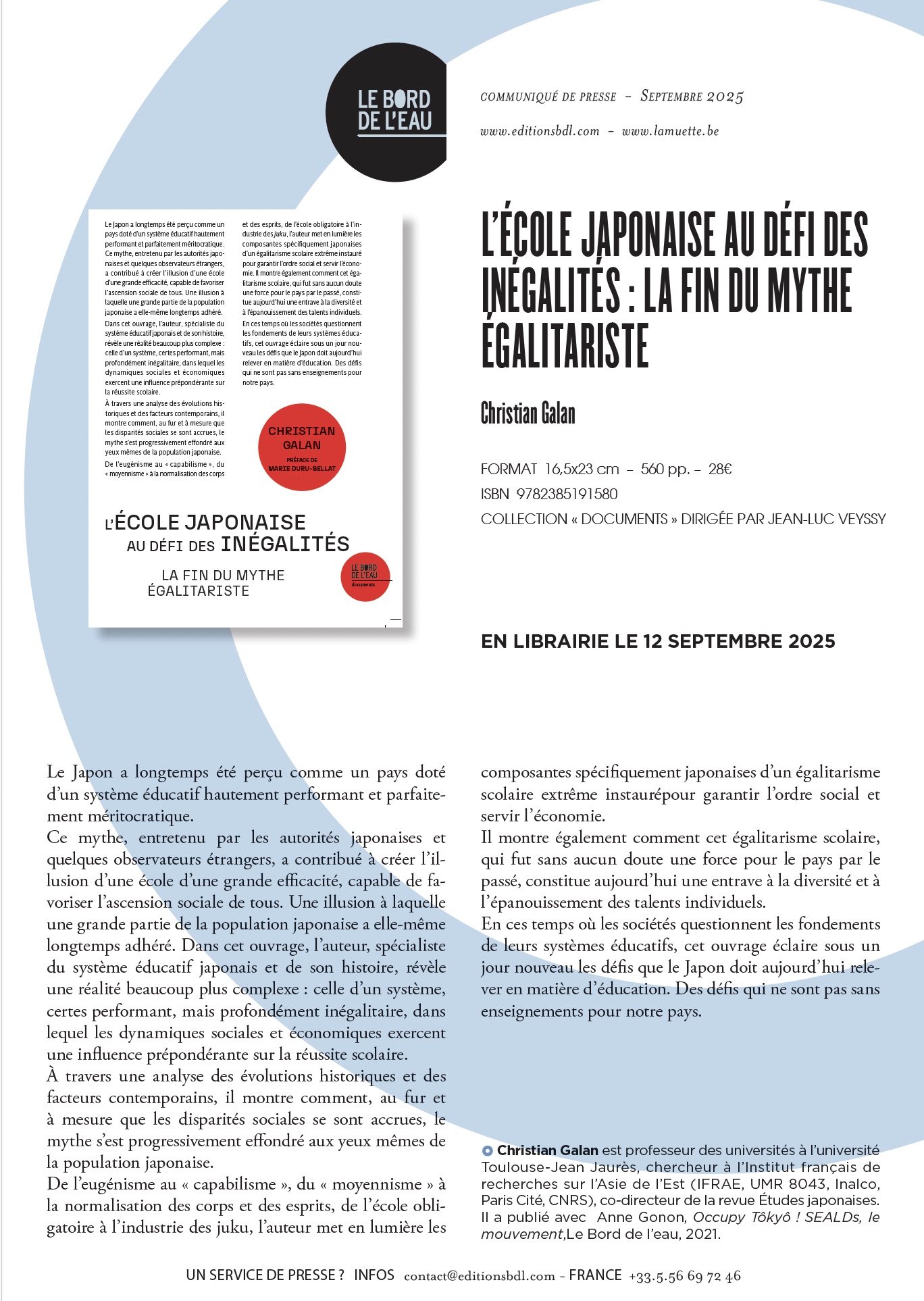La Maison de la culture du Japon à Paris a le plaisir de vous informer que la campagne de sélection des candidatures pour les programmes de subvention de la Fondation du Japon pour l’année fiscale 2026 est officiellement ouverte.
Nous attirons votre attention sur les subventions destinées au soutien des études japonaises et des projets de traduction et publication qui pourraient potentiellement vous intéresser :
Support Program for Translation and Publication
date limite de candidature : le 2 décembre, 13h00 (heure japonaise), 5h00 (heure française)
Cette subvention permet de financer une partie des coûts liés à la traduction et à la publication de livres japonais en dehors du Japon.
EN https://www.jpf.go.jp/e/program/culture.html#cul_7
JP https://www.jpf.go.jp/j/program/culture.html#cul_7
Grant Program for Japanese Studies Projects
date limite de candidature : le 2 décembre, 13h00 (heure japonaise), 5h00 (heure française)
Cette subvention promeut les études japonaises par des institutions à l’extérieur du Japon.
EN https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_7
JP https://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html#intel_7
Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program
date limite de candidature : le 2 décembre, 13h00 (heure japonaise), 5h00 (heure française)
Cette subvention permet aux doctorants et aux chercheurs en études japonaises d’effectuer des séjours au Japon dans le cadre de leur projet de recherche.
EN https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_5
JP https://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html#intel_5
Il est obligatoire de candidater directement en ligne. Les candidatures sous format papier ne seront pas acceptées.
Vous pouvez déposer votre candidature via les liens suivants :
公募申請サイト https://www.apply.jpf.go.jp/ja/Identity/Account/Login
Online Application Portal https://www.apply.jpf.go.jp/en/Identity/Account/Login
Nous proposons également des subventions en collaboration avec d’autres institutions, comme ci-dessous.
JF-CIJS-EAJS Fellowship program(Collaboration avec Tohoku University’s Center for Integrated Japanese Studies (CIJS))
date limite de candidature : le 21 novembre, minuit (heure japonaise), le 21 novembre à 16h00 (heure française)
Cette subvention permet aux doctorants en sciences humaines et sociales effectuant des recherches en Europe sur le Japon de mener des recherches à l’Université du Tohoku.
EN https://cijs.oii.tohoku.ac.jp/en/news/detail—id-69.html
JP https://cijs.oii.tohoku.ac.jp/news/detail—id-68.html
※ Il est possible de candidater à la fois à la subvention « Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program » et à celle-ci.
JF-GJS Fellowship Program (Collaboration avec Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo)
date limite de candidature : le 1er décembre, minuit (heure japonaise), le 1er décembre à 16h00 (heure française)
Cette subvention permet de soutenir les postdoctorants en leur offrant la possibilité de séjourner au Japon et de mener leurs recherches au sein de l’Institut des Etudes Avancées sur l’Asie de l’Université de Tokyo.
EN/ JP https://gas.ioc.u-tokyo.ac.jp/networking/2026-jf-gjs-fellowship/
※ Il est possible de candidater à la fois à la subvention « Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program » et à celle-ci. (Cependant, il est impossible de cumuler cette candidature avec celle pour le “JF-Nichibunken Fellowship Program”)
JF-Nichibunken Fellowship Program (Collaboration avec International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken))
date limite de candidature : le 1er décembre, minuit (heure japonaise), le 1er décembre à 16h00 (heure française)
Ce programme permet de soutenir les postdoctorants en leur offrant la possibilité de séjourner au Japon et de mener leurs recherches au sein de le Centre International de Recherche pour les Etudes Japonaises Nichibunken.
EN https://www.nichibun.ac.jp/en/research/employment/acceptance/#jf-nichibun
JP https://www.nichibun.ac.jp/ja/research/employment/acceptance/#jf-nichibun
※ Il est possible de candidater à la fois à la subvention « Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program » et à celle-ci. (Cependant, il est impossible de cumuler cette candidature avec celle pour le “JF-GJS Fellowship Program”)