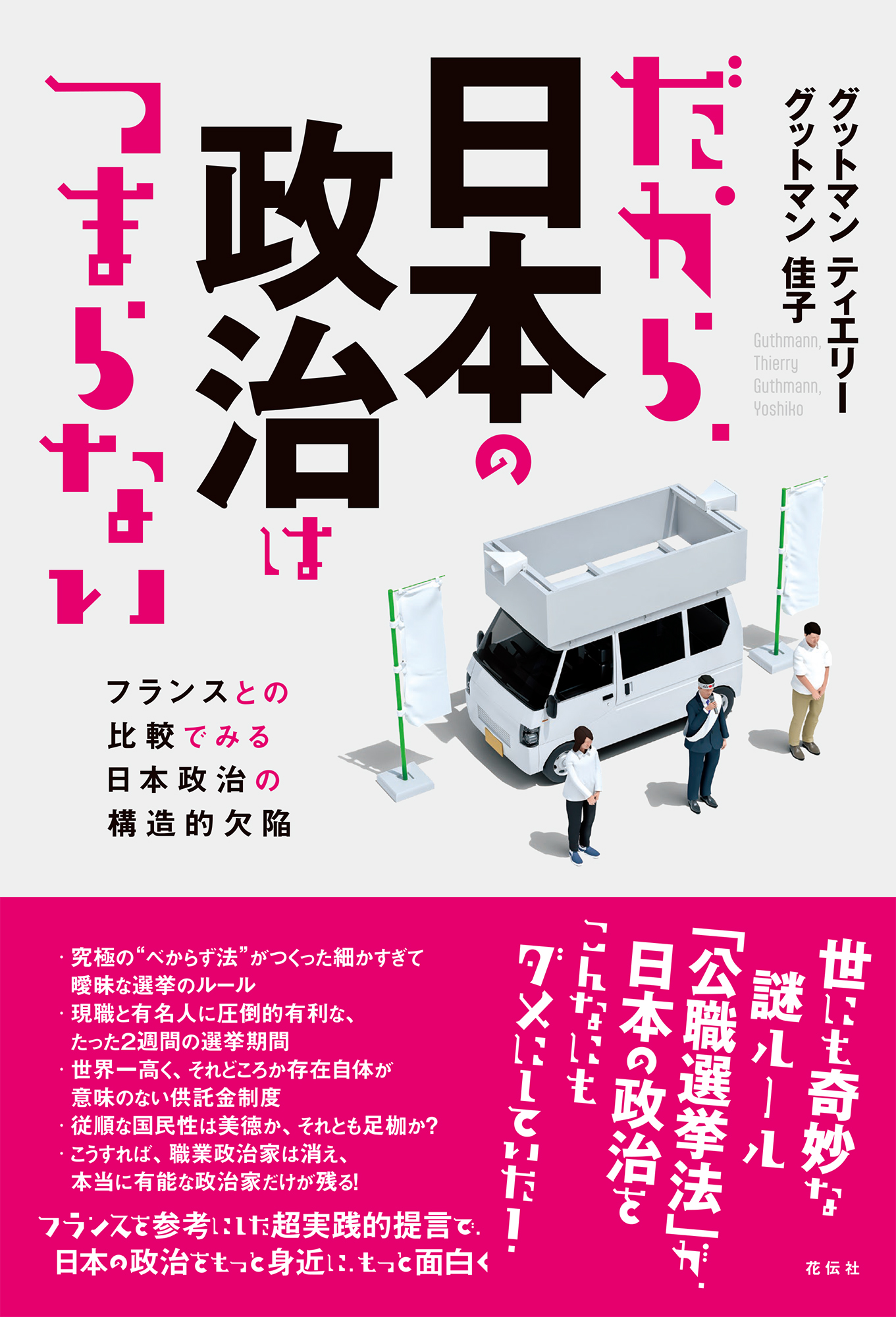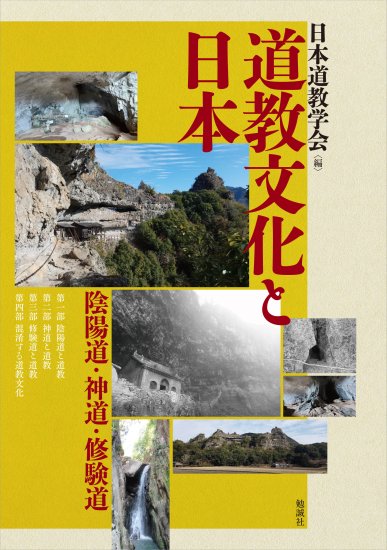Jean Bazantay a le plaisir de vous annoncer la soutenance de son habilitation à diriger des recherches, qui se tiendra mardi 20 mai 2025 à partir de 14h, Salon Borel, Inalco – Maison de la Recherche, 2 rue de Lille, 75007 Paris.
Le dossier présenté comprend un mémoire de synthèse de mes travaux intitulé « L’enseignement du japonais langue étrangère entre recherches linguistiques et pratiques didactiques », ainsi qu’un manuscrit inédit : « Naissance et développement d’une nouvelle discipline : le japonais langue étrangère au Japon (de l’ère Meiji à nos jours) ».
Le jury est composé de :
- M. Danh Thành DO-HURINVILLE, Professeur des universités, Université Marie et Louis Pasteur
- M. Gilles FORLOT, Professeur des universités, Inalco
- Mme Laurence LABRUNE, Professeure des universités, Université Bordeaux Montaigne
- M. Emmanuel LOZERAND, Professeur des universités, Inalco (Président du jury)
- Mme Christine LAMARRE, Professeure émérite, Inalco (garante)
- Mme Yumi TAKAGAKI, Professeure, Université Kwansei Gakuin
La soutenance est publique, et vous y êtes toutes et tous chaleureusement invité·e·s.