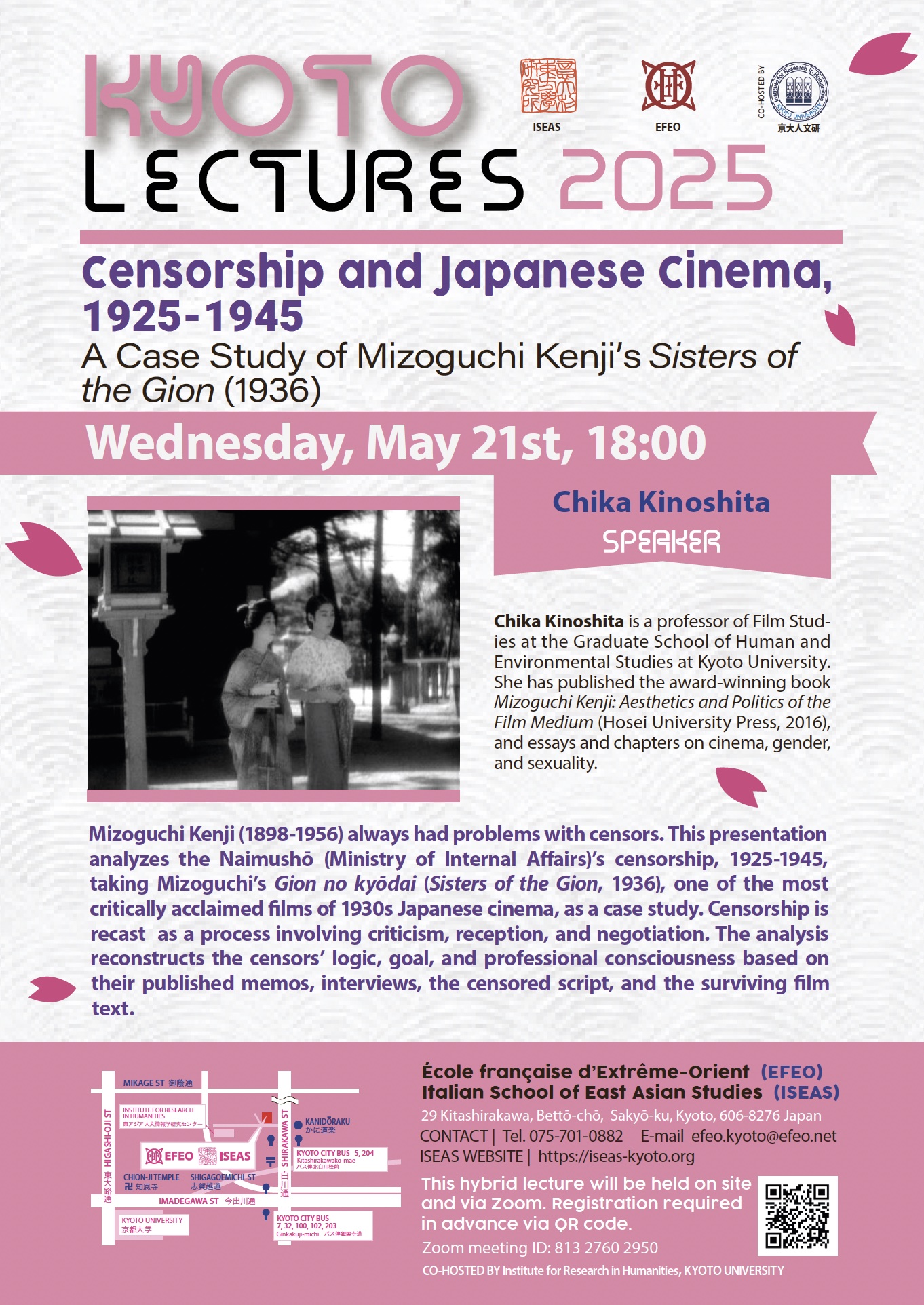ご担当者様
法政大学グローバル教育センターの杢屋と申します。
国際交流基金パリ日本文化会館 国重様より貴事務局をご紹介を頂き、連絡を入れさせて頂きました。
この度、『2026年度法政大学国際交流基金による外国人招聘研究員(HIF招聘研究員)招聘制度募集要項』を作成し、応募者を募集する運びとなりました。
法政大学は1980年に創立100周年を迎え、これを記念する事業の一つとして、教職員、在学生、卒業生、財界等からの寄付金の一部をもって「法政大学国際交流基金」を設置し、国際交流のいっそうの発展を図っています。ここに、この基金の果実による事業の一つとして、外国人招聘研究員を毎年、募集・選考のうえ招聘しています。
つきましては、以下のホームページに掲載しております募集要項を関係各位にご紹介くださいますよう、お願い申しあげます。願書も同ページよりダウンロード可能です。
URL: https://www.global.hosei.ac.jp/researchers/hif/
多くの優秀な若手研究者からの応募をお待ちしております。
以上、今後ともご厚情を賜りたく、お願い申し上げます。
法政大学
グローバル教育センター
A warm greeting from the Global Education Center, Hosei University in Tokyo, Japan.
We would like to inform you that the 2026 Application Guidelines for the Hosei International Fund (HIF) INTERNATIONAL SCHOLARS FELLOWSHIP have been completed and that we are now ready to accept applications from prospective candidates for the coming year.
Hosei University celebrated the 100th anniversary of its founding in 1980. In commemoration of this event, the Hosei International Fund was set up through contributions from faculty, students, alumni, and industry to further international relations. As one undertaking covered by this fund, foreign scholars are yearly invited to apply for a fellowship to conduct research at Hosei University.
At the following website, we have released the Guidelines, which we hope will be of use in making our program known to prospective candidates. The Application Form may also be obtained at the same website.
URL: https://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/
Thank you for your cooperation and continued support. We hope the response will be a large one.
Yours sincerely,
Global Education Center
Hosei University
—————————————————————————–
HOSEI University, Global Education Center,
Global Students and Scholars Support Office (GSO)
2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8160 Japan
TEL/FAX:03-3264-5475/4624
E-mail: hif@hosei.ac.jp
——————————————————————————