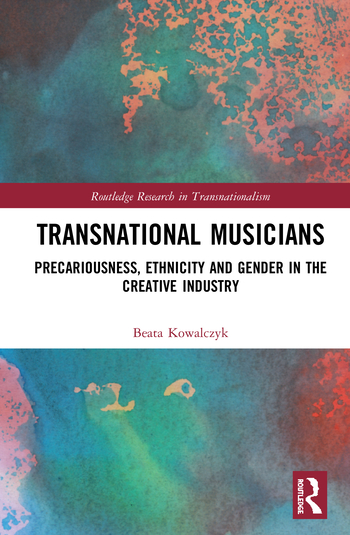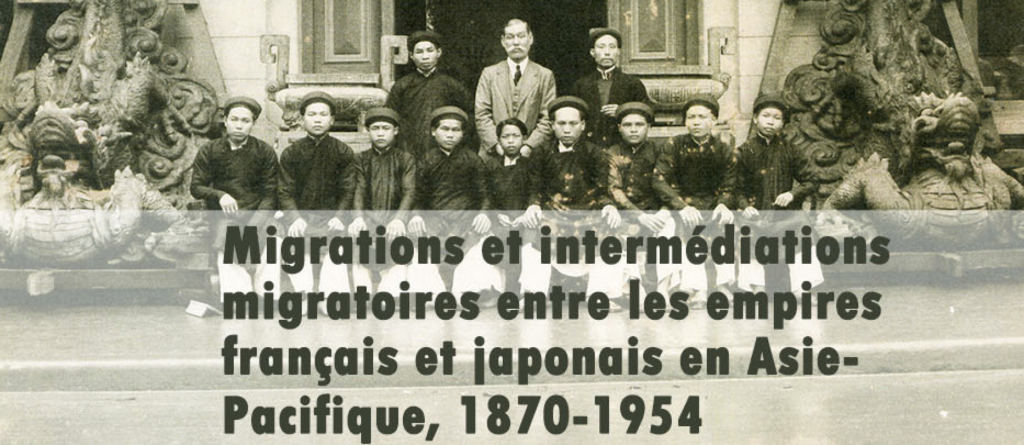Cette d’études sur la thématique « Voisinages en Asie : enjeux politiques, mobilisations, pratiques sociales » est organisée par l’équipe Populations japonaises (IFRAE – CRCAO) – Jean-Michel Butel (IFRAE) et Naoko Tokumitsu (IFRAE). Cet événement est cofinancé par le GIS Asie.
Mardi 19 janvier 2021, 10h-17h45
Pour y participer, il est nécessaire d’écrire aux organisateurs avant le 17 janvier à l’adresse jdevoisinage@gmail.com, en précisant :
1) vos nom et prénom,
2) votre adresse email,
3) votre institution de rattachement.
Un lien de connexion pour Zoom sera envoyé le 18 janvier, dans la matinée.
La participation à une partie de la journée est bien évidemment possible.
Présentation :
Cette journée d’étude vise à créer un temps d’échange entre chercheurs autour d’un objet d’étude situé au croisement de plusieurs disciplines. La notion de voisinage s’apparente en effet à un « concept fluide » (Forrest, 2007), qu’elle dénote un découpage administratif, une conception liée à un processus de participation tel qu’un comité de quartier, ou enfin une catégorie socialement construite dans le temps par les pratiques des résidents (Ibid.). Les relations vicinales peuvent en effet s’avérer très variées : il conviendra d’en cerner et d’en sérier les contours, pouvant recouvrir des entités plus ou moins larges telles que l’arrondissement et le centre-ville, mais également des rapports microlocaux noués dans la rue ou au sein de la résidence (Authier, 2008).
L’enjeu de cette journée d’étude consiste dès lors à croiser les analyses sur la manière dont évoluent les liens de voisinage dans les pays d’Asie, dans un contexte où les évolutions démographiques dessinent, dans le cas de l’Asie de l’Est, comme une « modernité compressée » (Chang 2010), qui s’accompagne d’intenses changements sur les plans économique, social et culturel. Nous discuterons notamment autour de trois principaux angles d’approche en rapport avec le voisinage : les associations religieuses, les lieux de socialisation et enfin les enjeux liés aux mobilisations et au contrôle. À travers des échanges interdisciplinaires, nous nous intéresserons aux rapports que les riverains entretiennent avec les autorités publiques, ainsi qu’au sein des communautés de voisins elles-mêmes, en considérant les formes de mobilisation de la société civile.
Programme
10h -10h10 : Introduction : Naoko Tokumitsu (IFRAE/INALCO)
Session 1 : Voisinages et associations religieuses
Discutante : Florence Galmiche (CRC/Université de Paris)
10h15 (20 min de présentation + 10 min de discussion)
Marta Pavone (IFRAE/INALCO) : « Consolidation du pouvoir local à travers la construction d’un temple : les Lü du quartier Nanshijiao à Taïwan. »
10h45
Adeline Herrou (LESC/CNRS) : « La course aux voisins d’un temple taoïste sauvé d’une démolition de village (région de Xi’an, Chine). »
11h15
Fabienne Duteil-Ogata (IIAC/ Université de Bordeaux-Montagne – CLARE) : « Les rapports de l’association de voisinage avec le pouvoir religieux : rapports de give and take. (Japon) »
11h45 : Discussion 1
12h – 13h : Pause déjeuner
Session 2 : Voisinages et lieux de socialisation
Discutante : Joanie Cayouette-Remblière (INED, CNRS)
13h
Justine Rochot (CECMC/EHESS- CEFC/CNRS/MAEE) : « Le voisin, l’amant et le concitoyen. Figures du lien social dans les rassemblements de retraités d’un parc pékinois. »
13h30
Nicolas Pinet (CRJ/EHESS-LCSP/Université de Paris) : « Une forme particulière de voisinage : les grands ensembles d’habitat social au Japon. »
14h
Marie Gibert-Flutre (CESSMA/Université de Paris)
Présentation de ses ouvrages :
– Les envers de la métropolisation. Les ruelles de Hồ Chí Minh Ville, Vietnam, CNRS Éditions, 2019
– Asian Alleyways : An Urban Vernacular in Times of Globalization, Amsterdam University Press, 2020 (ouvrage co-dirigé avec Heide Imai)
14h30 : Discussion 2
14h45-15h : Pause café
Session 3 : Voisinages, mobilisations, contrôle
Discutante : Marie Gibert-Flutre (CESSMA/Université de Paris)
15h
Delphine Vomscheid (CRCAO/EPHE) : « Classements patrimoniaux de quartiers anciens au Japon : de l’opposition des habitants aux intérêts économiques. »
15h30
Frédéric Burguière (ENS Lyon/Université de Cergy) : « Les “relations de voisinage” en période d’épidémie. L’apport des outils numériques utilisés en Asie en 2020. »
16h
Émilie Letouzey (LISST/Université de Toulouse) : « Mes cent mille voisins. Identité et stratégies promotionnelles dans les associations locales d’Osaka. »
16h30 : Discussion 3
16h45-17h15 : Discussion générale animée par Jean-Michel Butel (IFRAE/INALCO)
Liens vers les sites de l’événement : Ifrae & Gis Asie