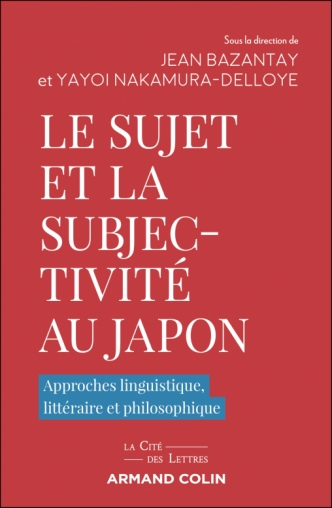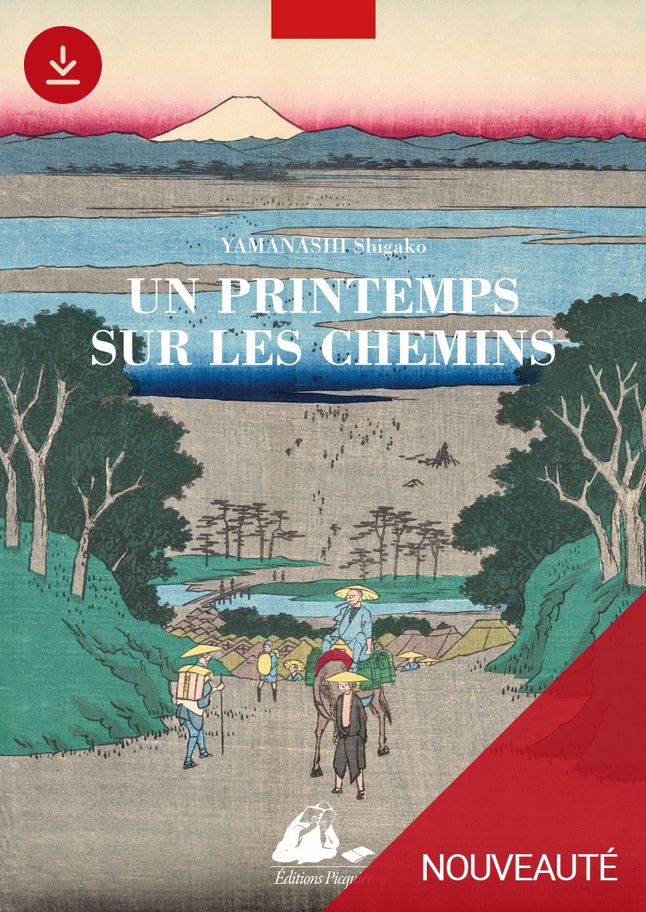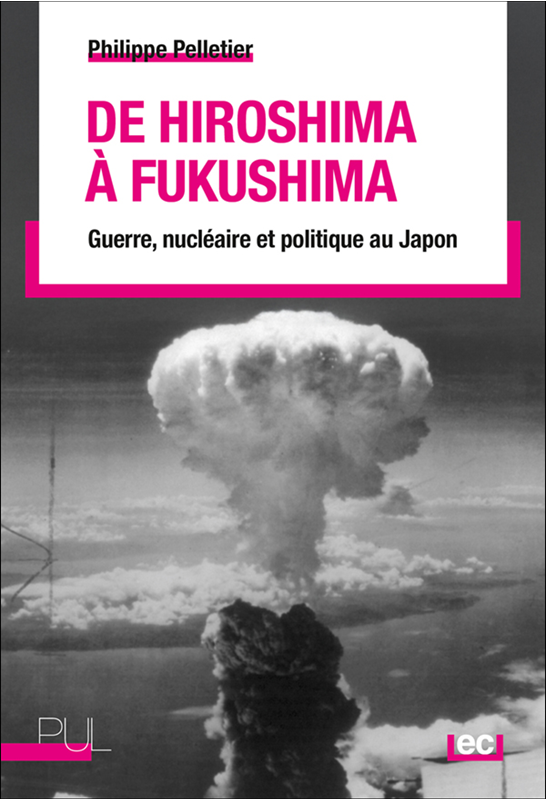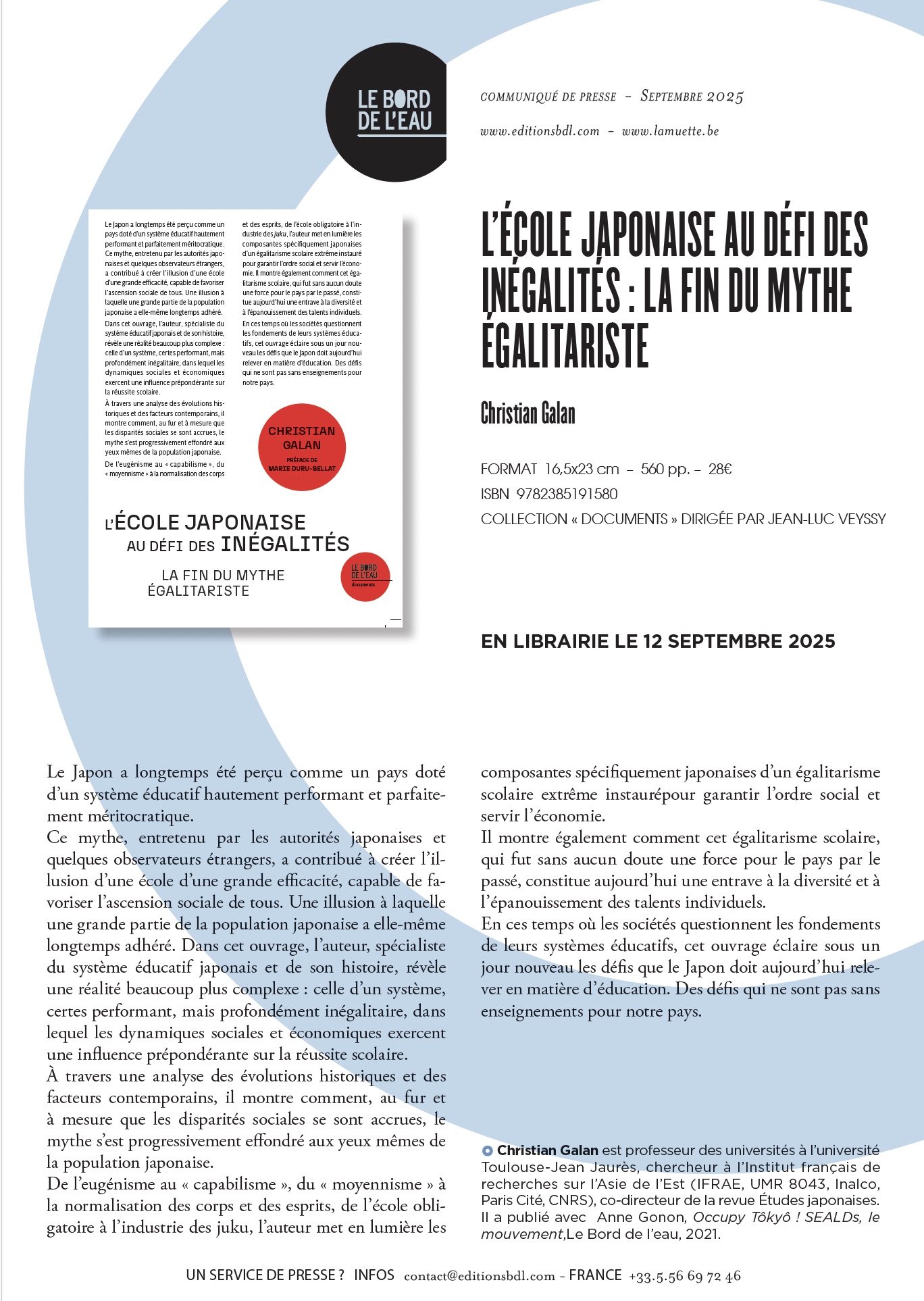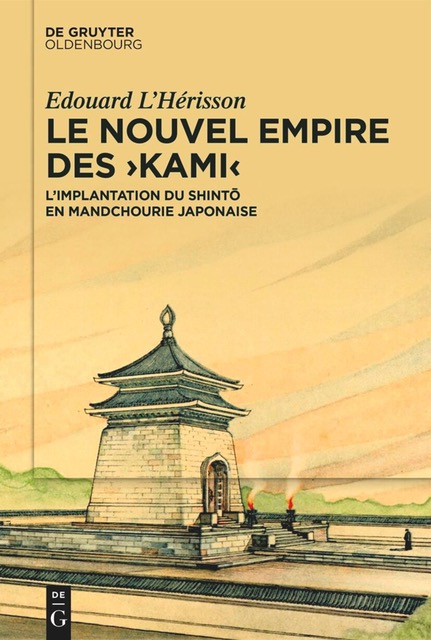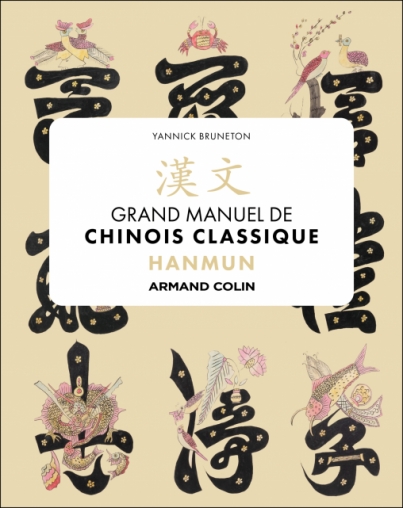Yayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay et l’ensemble des membres du groupe « Langue et subjectivité » de l’IFRAE (UMR 8043) ont le plaisir de vous annoncer la parution de leur ouvrage collectif, qui concrétise les travaux menés par l’équipe durant le quinquennal 2020-2024.
Le sujet et la subjectivité au Japon. Approches linguistique, littéraire et philosophique
Paris : Dunod / Armand Colin, coll. La Cité des Lettres, 2025 → Lien vers l’ouvrage
Argumentaire :
Comment se pense le sujet dans la culture japonaise, où la notion d’individualité se conçoit selon d’autres modalités qu’en Occident ? Quels sont les modes d’expression et les traces du « je » dans l’activité langagière ?
Dans une approche transdisciplinaire alliant linguistique, philosophie et littérature, le présent ouvrage explore les spécificités du concept de subjectivité dans la langue et la culture japonaises à travers ses formes et réalisations linguistiques.
Contributeurs (par ordre alphabétique) :
Makiko Andro-Ueda, Jean Bazantay, Ameline Garnier, Satoshi Kinsui, Yukiko Kuwayama, Yannick Maufroid, Yayoi Nakamura-Delloye, Takako Saitō, Rie Takeuchi-Clément, Sumie Terada, Masaki Yamaoka, Aki YoshidaYayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay et l’ensemble des membres du groupe « Langue et subjectivité » de l’IFRAE (UMR 8043) ont le plaisir de vous annoncer la parution de leur ouvrage collectif, qui concrétise les travaux menés par l’équipe durant le quinquennal 2020-2024.
Le sujet et la subjectivité au Japon. Approches linguistique, littéraire et philosophique
Paris : Dunod / Armand Colin, coll. La Cité des Lettres, 2025 → Lien vers l’ouvrage
Argumentaire :
Comment se pense le sujet dans la culture japonaise, où la notion d’individualité se conçoit selon d’autres modalités qu’en Occident ? Quels sont les modes d’expression et les traces du « je » dans l’activité langagière ?
Dans une approche transdisciplinaire alliant linguistique, philosophie et littérature, le présent ouvrage explore les spécificités du concept de subjectivité dans la langue et la culture japonaises à travers ses formes et réalisations linguistiques.
Contributeurs (par ordre alphabétique) :
Makiko Andro-Ueda, Jean Bazantay, Ameline Garnier, Satoshi Kinsui, Yukiko Kuwayama, Yannick Maufroid, Yayoi Nakamura-Delloye, Takako Saitō, Rie Takeuchi-Clément, Sumie Terada, Masaki Yamaoka, Aki Yoshida